
Salim Hatubou s’en est allé un 31 mars 2015 à Marseille, sa cité d’adoption. Il était le plus prolifique des auteurs comoriens de la jeune génération. Il était surtout un grand défenseur du conte sur les scènes du monde. De la ville d’Auxerre en France à Tokyo au Japon, en passant par Sainte-Suzanne à la Réunion, le fils du Hanmanvu a promené ses personnages si facétieux, issus d’un imaginaire d’archipel au destin lunaire, avec un talent rare, consacré depuis la parution de son premier livre, Les Contes de ma grand-mère, en 1994 aux éditions L’Harmattan. Entretien[1].
Il y a longtemps que la tradition des contes sous la pleine lune a disparu de ce pays. Le conte est devenu simple objet d’étude. A peine le lit-on dans l’Archipel lorsqu’il passe à l’écrit. Ce phénomène explique-t-il votre recours au théâtre pour le défendre ?
Il y a de cela, en effet, mais le fait d’avoir recours au théâtre est intéressant. Car je place le conte dans son milieu naturel : l’oralité. Bien entendu, quand je suis sur scène, je ne récite pas, je conte. Il y a une différence fondamentale entre ces deux termes, parce que conter c’est savoir ouvrir des fenêtres à des improvisations ou aux imprévus.
Comme une manière de retrouvailles avec les histoires contées par votre grand-mère au temps de l’enfance…
Mes jeux de scènes, ma façon d’interpeller le public et de l’impliquer dans les intrigues, ma manière de poser la voix… Je tiens tout cela de ma grand-mère, qui faisait du théâtre sans s’en rendre compte. Quand je suis sur scène, non seulement, je retrouve les histoires de mon enfance, mais je retrouve également les ambiances, les odeurs liées à ces veillées d’autrefois. J’ai besoin de cela pour emporter mon public, sinon ce serait artificiel.
Le théâtre vous offre un espace rêvé…
Exactement. Le théâtre m’a permis de véhiculer le conte vers un autre public, celui qui n’ouvrirait pas mes livres, soit parce qu’il ne sait pas lire (les enfants par exemple ou d’autres personnes illettrées), soit parce qu’il n’a pas le temps de lire. Le théâtre a donc été le meilleur medium pour l’oralité du conte. Ce qui me paraît être une très bonne chose.
La tradition du conte se transmettait sur la base d’une communauté rassemblée. Elle se vivait aussi comme une nécessité culturelle pour les Comoriens à une époque. Alors que le théâtre se représente comme une pièce rapportée de nos jours dans ce paysage insulaire…
Ceux qui pensent que le théâtre est une pièce rapportée n’ont pas pris le temps d’observer le quotidien du Comorien, de voir le comorien évoluer dans son milieu social. La place publique, par exemple, est une sorte d’arènes où se joue du comique, de la tragédie…
A mon avis, oui, le théâtre tel que nous le voyons, avec notre regard occidentalisé, peut paraître comme une pièce rapportée. Mais c’est tout simplement parce qu’il a été intellectualisé, disséqué, étudié, normalisé, formaté avec des règles. Dans une veillée de contes, telle que je l’ai vécue chez ma grand-mère à Milepvani, le théâtre n’était pas dans les contes ou les légendes qu’on racontait, mais l’assemblée elle-même jouait une pièce.
On peut dire que vous avez inventé un personnage inédit sur la scène de l’archipel. Le conteur au kilomètre. Une sorte de conteur professionnel. Ce qui n’existait pas dans la tradition, où tout le monde pouvait se fendre de son quart d’heure de célébrité avec un petit conte raconté par grand-mère une demi-heure avant le rendez-vous pris sous le clair de lune par toute la communauté du village rassemblée…
En réalité, je n’ai rien inventé du tout. Je transmets l’expérience que j’ai eue de mon enfance. Ma grand-mère était la conteuse. Elle menait ses veillées, et puis d’autres, dans le public, pouvaient se fendre de leur quart d’heure de célébrité, comme vous dites. Mais c’était un apprentissage. Moi quand, tout petit, je profitais des veillées de ma grand-mère pour raconter une petite histoire, j’apprenais le « métier ». Ma grand-mère nous corrigeait, nous donnait des conseils. Et on pouvait raconter la même histoire toutes les nuits jusqu’à ce qu’on arrive à emporter le public. La seule différence entre ma grand-mère et moi, c’est que je raconte sur scène, dans des théâtres, alors qu’elle, elle racontait devant sa petite case.
Mais là où le conte provoquait une adhésion totale, le théâtre suscite des interrogations. Mélange des traditions et forme d’expression nouvelle…
Je pense que ce mélange de traditions et de formes d’expressions nouvelles est une richesse. Cela donne une autre dimension à un théâtre qui se dirait un «théâtre comorien» avec ses particularités. Et si, finalement, le théâtre nous permettait de revenir aux veillées d’antan, et s’il nous réconciliait avec le conte…
Le passage d’une tradition vers une autre passe aussi par la magie du verbe. Quelle langue pour dire le conte au théâtre ? Votre personnage allume son compteur de mots pour ne pas fatiguer ses auditeurs. Vos spectacles ne durent pas la nuit. Vos spectateurs, même Comoriens et nostalgiques d’une époque bénie pour le conte, ne sont pas capables de tenir plus de deux heures à l’écoute de Madi, l’idiot voyageur, votre personnage au théâtre…
Pour la première question, je pense que le conte doit être dans la langue de celui qui le reçoit. Personnellement, je le dis en français, mais je garde les chants, les expressions d’ouverture (Allahalele/Gombe) et de fermeture (Io nde hale yahangu yitsike djambe yitseke djambuzi baheni yapvira yotsoyirema pi) en comorien. C’est essentiel pour moi. J’ai eu, avec d’autres conteurs, à faire de véritables veillées, qui finissent à l’aube. Les spectateurs restent, et se laissent emporter. Mes spectacles peuvent aller d’une heure à quatre heures parfois. Mais cela, on le fait quand le public est en symbiose avec le conteur, bien sûr. La structure théâtrale dans laquelle je mets Madi l’idiot voyageur en scène permet, justement, de rendre le spectacle élastique, en termes de durée.
Il vous a donc fallu inventer une dramaturgie propre au conteur. A la base, vous n’êtes pas issu du théâtre, ni de la tradition du conte au sens strict, même si c’est votre grand-mère qui vous a initié aux premières histoires. Vous êtes auteur de fictions. Donner à voir et à entendre vos histoires sur scène n’a pas dû être simple ?
Je ne dirai pas que je suis un auteur de fictions qui monte sur scène, parce que je pourrais aussi dire que je suis un conteur qui écrit des fictions. Vivre pleinement ces deux exercices est un réel bonheur, peut-être parce que la première fois que je suis monté sur scène a coïncidé avec la parution de mon premier livre, Les contes de ma grand-mère[2]. En écrivant ce recueil, j’ai puisé dans l’oralité bien sûr. Et cette écriture m’a permis de revenir à l’oralité. C’est-à-dire que pour la promotion du livre une chaine de télévision [M6] m’a demandé de monter sur scène pour qu’elle puisse filmer et faire un sujet. J’ai alors continué. Cela n’a pas été facile, en effet, mais, comme je le disais, je me suis approprié les méthodes de ma grand-mère.
Les gens du conte par le passé jouaient sur l’interaction public/conteur. Le conte était le lieu de la mémoire. Mythes, légendes et autres croyances s’y logeaient. Une certaine vision du monde, partagée par le grand nombre, s’y détachait. Le théâtre donne l’impression de désacraliser tout cela, d’autant qu’il offre la possibilité d’un plaisir égoïste, qui n’est pas toujours partagé par le grand nombre, et se situe hors de l’enclave communautaire.
Vous avez raison. Personnellement, j’essaie de m’approprier la méthode du théâtre-forum pour certains contes dans mes spectacles. Pour certaines histoires, le public devient spect-acteur. Ils peuvent changer la suite du conte, par exemple, s’opposer à une injustice relatée. On peut dire que cela peut dénaturer, voire changer, le conte comorien. Mais je ne crois pas. Pour la seule raison que je choisis les moments où je fais intervenir le public, me disant que d’une façon ou d’une autre, je pourrai redresser la barre pour que le conte suive son chemin initial. J’ai, pour ma part, volontairement désacralisé le conte, sinon il serait ennuyant. Or, les gens viennent à mes spectacles pour s’évader et passer un bon moment. D’ailleurs c’est une des raisons pour lesquelles je préfère mettre la question de la mémoire en filigrane.
Ceux qui rentrent dans une salle par exemple se soucient peu de savoir s’ils se connaissent. Alors que ceux qui venaient se retrouver dans le quartier pour une veillée de conte au village semblaient tous se connaître. Chacun connaissait le visage de l’autre…
Tout dépend des lieux où les spectacles ont lieu. Quand c’est dans des villages du fin fond de la France, les gens se connaissent, c’est très convivial. Parfois, dans certains festivals de contes, les organisateurs essaient de recréer les conditions et les atmosphères d’autrefois, de réduire le plus possible l’anonymat, de faire assoir le public par exemple en cercle et sur des tapis.
Le théâtre au sens contemporain du terme impose d’autres rapports avec le public. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans ce travail d’adaptation et d’interprétation à la scène du conte traditionnel.
La grande difficulté était de maintenir le conte comme conte traditionnel, et non comme conte contemporain. Par exemple, par souci de plaire à leur public, certains conteurs vont mettre un téléphone portable entre les pattes d’un lion. Personnellement, je ne le fais pas. Une autre difficulté de taille : on trouve certains contes qui peuvent paraitre immoraux dans le répertoire de ma grand-mère (quand, par exemple, un sultan rend service à un orphelin qui, en retour, le tue pour occuper son trône) ou horribles (je pense à ce conte où on enlève la peau d’un jeune homme pour en faire un tam-tam). J’avoue que j’ai eu du mal à raconter ces histoires sur scène devant un public occidental. Et puis je me suis dit que le conte comorien n’échappe pas au conte universel, il a donc ses travers. Qui ne se souvient pas de barbe bleue ? C’est violent comme conte, et, pourtant, on le raconte aux enfants.
Est-ce qu’il vous arrive d’inventer des histoires que vous additionnez à celles racontées par votre grand-mère…
Tous les contes que je raconte sur scène m’ont été transmis par ma grand-mère. Je ne raconte pas ceux que j’ai lus dans les livres. Quant aux histoires que j’invente, j’en fais des albums illustrés. C’est important pour moi de ne raconter que les contes qui m’ont été donnés par ma vieille conteuse.
Une dernière question. Comment se déroule votre spectacle justement ?
Pour cette question, j’aimerais vous faire part d’un compte rendu, publié sur le site de l’académie de Dijon par Joëlle Dupré, une documentaliste d’un collège à Auxerre : «Salim Hatubou revendique, dès le début de son intervention, son appartenance à une lignée de conteurs, et nous rend témoins et complices des circonstances par lesquelles il l’est devenu. Ce rôle, dévolu à son aîné, lui échoua lorsque son frère fut dans l’incapacité de le tenir, puni qu’il avait été pour n’avoir pas respecté les recommandations préalables à la diction et à l’écoute d’un conte. Avertis, les auditeurs sont invités, pour ne pas subir le même sort, à ponctuer le récit de « Gombé » en réponse au « allahalele » du conteur et, leur attention ainsi assurée, ils suivent le récit de Salim avant d’avoir pu faire la part de l’imaginaire et du vrai. Entre temps celui-ci s’est paré des attributs vestimentaires du conteur propres à nous dépayser et nous emmener dans un village perdu de la brousse comorienne. Salim Hatubou qui, sans en avoir l’air, nous a déjà offert plusieurs récits, confie alors à son public, sous le sceau du secret et avec sa complicité, sa parenté avec l’idiot du village prénommé Madi dont il veut bien nous conter l’histoire. Un conte en amène ainsi ou en rappelle un autre. Les structures des différents contes s’emboîtent les unes aux autres et leurs complexités sont adaptées au public, jeunes ou adultes. Tous sont charmés et la question des enfants, curieux de connaître la vérité relative aux premiers propos et mise en garde de Salim démontre, s’il en était encore besoin, que ce dernier a pleinement réussi dans son entreprise de séduction et d’immersion dans le monde des contes ».
Propos recueillis par Soeuf Elbadawi
[1] Les Bruts du Muzdalifa House/ Vol. I, 2015.
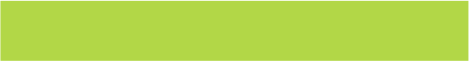



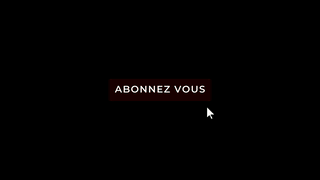
Réagissez à cet article